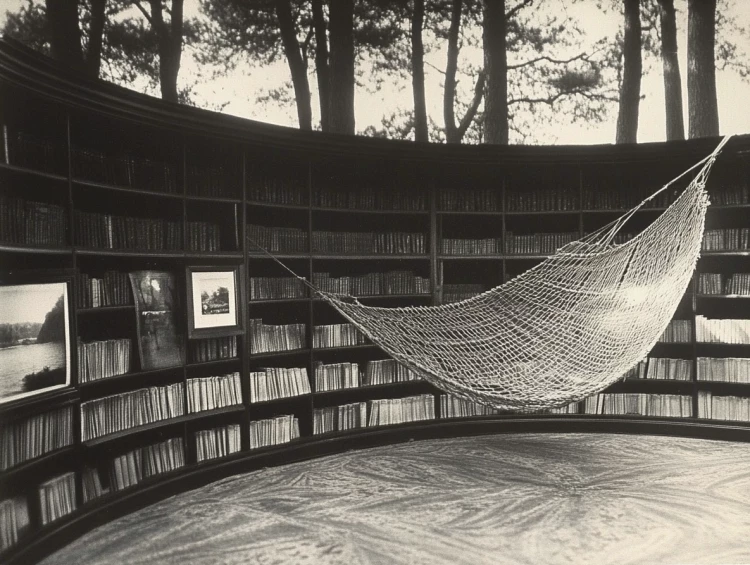
Nous vivons la fin d’une ère : celle où on pouvait s’orienter dans le monde en faisant le partage entre le sujet et l’objet. Le pari théorique dans lequel nous nous engageons est que désormais tout se passe au milieu. Nous ne vivons ni des déterminations (objectives), ni des projections (subjectives), mais des dispositions et des coexistence.
Par l’expression de « technologies de l’esprit », nous voulons marquer ce point où les techniques et les esprits coexistent et se disposent réciproquement, une zone d’indétermination dans laquelle les séances seront autant de coups de sonde.
Organisé par : Pierre Cassou-Noguès, Baptiste Loreaux, Alban Leveau-Vallier.
http://pierrecassounogues.org
Soutiens & partenaires : Laboratoire LLCP EA 4008 (université Paris 8), IUF Institut Universitaire de France.
•
Nous accueillons Léa Bismuth pour la parution de son nouveau livre : Étoiles communes - Vers une écologie cosmique, Actes Sud. Ce livre se présente comme une enquête philosophique de 1871 à nos jours. Il prend pour point de départ une méditation astronomique hallucinée, écrite par le penseur socialiste Auguste Blanqui pendant l’épisode insurrectionnel de la Commune de Paris. À partir de là, une question : la nuit étoilée serait-elle un véritable outil d’émancipation politique ? Entre l’essai et le récit, /Étoiles communes/ raconte cette histoire au présent, voyageant entre la Bretagne et le Texas, à l’heure de l’astrocapitalisme et pendant que des milliers de satellites hantent l’orbite basse. À l’heure de Starlink, serait-il possible de monter des barricades cosmiques ? Une constellation résistante se dessine dans l’obscurité : celle de la puissance de l’intelligence-artiste, seule en mesure désormais de se soulever et d’écrire un contrat sidéral. Vers une écologie politique et cosmique.
Léa Bismuth est docteure en théorie de l’art (EHESS), critique d’art et commissaire d’exposition. De 2023 à 2025, elle a été ATER à temps plein en sciences de l’art (XX, XXIè) au départements des Arts de l’Université Picardie Jules Verne (Amiens). En tant qu’essayiste, elle a publié L’art de passer à l’acte (PUF, Coll. Perspectives Critiques, 2024) et Etoiles communes - vers une écologie cosmique (Actes Sud, 2026).
Site internet : https://actes-sud.fr/catalogue/ecologie-developpement-durable/etoiles-communes
•
L’écoute écologique est un sujet doublement négligé dans le champ de la philosophie de l’environnement : négligé, d’un côté, par les philosophes du son et de l’écoute qui, jusqu’à une période très récente, ne s’intéressaient pas aux questions écologiques et négligé, de l’autre, par les philosophes de l’environnement qui ne s’intéressent que peu aux questions du sonore et de l’écoute. Contestant les dualismes modernes anthropocentrés et visiocentrés, l’écoute écologique ouvre vers une expérience de participation avec la nature s’inscrivant dans une ontologie relationnelle. Mais l’écoute écologique est aussi une question éthique et politique. Elle permet de révéler ce qui, au sein de « l’Anthropocène sonore », apparait comme des injustices écoacoustiques. Répondre à ces injustices engage le développement de certaines vertus écologiques et ouvre aussi la possibilité d’imaginer la proposition de reconnaissance politique de « droits sonores ».
&
"This presentation begins with an invitation au voyage as Pierre Cassou-Noguès summons me to join him on an eco-philosophical bike tour of the Atlantic Coast of France. Having established this narrative schema as an adventure in “velosophy," I provide a history of this genre, highlighting how it is concerned not only with ecology but also with technological invention and progress. This leads to a discussion of the technics of cycling, from the contested invention of the first bicycle, le vélocipede, to the first dérailleur, e-bikes, and ultimately the doping scandals of the Tour de France. These examples demonstrate that cycling is an essential vehicle for an embodied philosophy of technics. Along the way, I will unpack the problem of the “purest” bicycle, provide a dromological interpretation of the e-Vélib, and speculate about the best methods for attaining the physiocognitive state of “velosophical flow.”
&&
Discussion avec la salle avec Damien Delorme et Marcel O'Gorman
•
Nous recevrons l’écrivain, chercheur et artiste Eryk Salvaggio, qui problématisera son travail sur les Intelligences artificielles à partir de la question du bruit, en contraste avec celle du signal. Son intervention, qui sera en anglais, est intitulée « Noising and denoising », et en voici une courte annonce : « Noise and the eradication of noise are at the core of AI generated media, but the political and social dimensions of this are rarely considered. What is noise and what does its removal entail? What symbolic representations determine value in an AI model, and which dictate what is waste? ».
Site internet « la forêt cybernétique » : https://www.cyberneticforests.com/about
•
Le 27 octobre, nous recevons Daniel Ross, traducteur en anglais de Bernard Stiegler en Australie. Il nous parlera entre autre du dernier livre qu'il a traduit : Qu’appelle-t-on Panser ?Au-delà de l’Entropocène Nous commencerons par projeter l'extrait d'un de ses films.
Bernard Stiegler's philosophy of technology : "For Bernard Stiegler, philosophy starts with the question of technics, then for most of its history forgets this question, and ultimately rediscovers that it was never anything other than this question. But this question of technics is first of all, and above all, the question of technics as a form of memory, opening the possibility of knowledge but also tending to eliminate it. With the vast increases in speed that come with computer network technologies, this tendency moves increasingly towards the elimination of the knowledge-as-non-knowledge that characterizes us as beings who anticipate our mortality. Which is to say, the elimination of time itself. So-called artificial intelligence raises these issues in a new way, beyond what Stiegler was able to experience during his lifetime, but in a way anticipated by him, both analytically – as tendencies towards denoetization, cinematization, and uncertainty – and existentially – as what he calls an immense regression."
Daniel Ross has translated numerous books by Bernard Stiegler, including most recently Nanjing Lectures 2016-2019 (Open Humanities Press) and The Age of Disruption: Technology and Madness in Computational Capitalism (Polity Press). With David Barison, he is the co-director of the award-winning documentary about Martin Heidegger, The Ister, which premiered at the Rotterdam Film Festival and was the recipient of the Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR) and the Prix de l’AQCC at the Festival du Nouveau Cinéma, Montreal (2004). He is the author of Political Anaphylaxis (OHP, 2021), Violent Democracy (Cambridge University Press, 2004) and numerous articles and chapters on the work of Bernard Stiegler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"The Disruptive Condition and Philosophy’s Care"
The emergence of radical disruptiveness as such characterizes our broad present. Entering the Disruptive Condition, as I call it, forces us to revisit and repeat the question of what it means to think. This intervention outlines the Disruptive Condition as the regime of historicity that has begun to organize anthropocenic life since the 1970s, but whose escalation we are experiencing today in the form of a nihilistic policy of breaking, smashing and shattering institutional structures, social relations and every form of futurity in general. Against this backdrop, Bernard Stiegler's redefinition of thinking (penser) as a caring (panser) which responds to the epochal challenge of this regime, is called upon. What is meant by philosophy‘s care? To what end, from where and on what grounds is philosophy practiced today? It is about the contouring of this question, which can only be posed as a historical question on the ground ––or better in the abyss––of the Disruptive Condition. »
See also : https://journals.openedition.org/appareil/132
La séance du séminaire Technologies de l’Esprit du 5 mai croisera les deux interventions de Natalie Blot (doctorante en chimie à l’ESPCI) et d’Orane Kail (doctorante en philosophie à Paris VIII).
« Ma séance sera sur la relation entre l'organisme et l'environment dans deux domaines liés, la biologie de l'evolution et l'ecologie. Je presenterai le paradigm adaptationiste fort de la theorie de l'evolution, pour ensuite le critiquer d'un point de vue scientifique avec l'importance notamment des interactions inter-especes et de l'organisme avec son environment. Je continuera par presenter un point de vue philosophique, mais ecrit par des biologistes: le point de vue de Richard Levins & Richard Lewontin, biologistes et marxistes americains, surtout actif des 70s a environ 2010 et celui de Jakob von Uexkull, biologiste allemend dont je traiterai sur des ecrits de 1920 a sa mort en 1944.
Si vous voulez lire quelque chose pour vous preparer a la seance, je joins un court essai de Lewontin et Levins au sujet, ainsi qu'un article de Pankaj Mehta, Professeur de Physique a Boston University qui utilise ces idees pour parler de la biologie contemporaine et du Big Data. https://jacobin.com/2014/01/theres-a-gene-for-that
« Je vais tenter de dessiner un substrat symbolique, d'ordre mythologique, à l'innovation robotique : il y a un mythe qui en tant que structure de pensée conditionnerait la conception de vie mécanique artificielle, malgré le discours positiviste premier de ceux qui se présentent comme l'aboutissement de la pensée scientifique innovatrice. Je pense qu'il y a une espèce de "galaxie symbolique" concernant les robots autour de la figure de Prométhée, qui précède toute pensée de la créature artificielle, et de la relation créateur/création/créature lorsqu'il s'agit d'un artefact technique. Le talk va surtout chercher à bien éclaircir ce champ symbolique, pour le mettre au jour et le caractériser extérieurement, et ensuite on va tenter de rentrer dedans pour voir ses conséquences sur les représentations qu'on a des robots.
Pour la séance du séminaire Technologies de l’Esprit du lundi 28 avril, nous avons la chance d’accueillir Jan Söffner, qui nous vient d’Allemagne. Sous le titre « Virtualisation de la pensée », il abordera le problème classique du test de Turing et des développements récents de l'intelligence artificielle. Voici l’approche non-classique de ce problème classique telle que la formule son auteur : « Cela me donnerait l'occasion de relire l'IA dans le contexte du "jeu de l'imitation" et de poser la question a) dans quelle mesure l'IA est mimétique (réponse : bien plus qu'on ne le pense). Et b) que se passe-t-il si on lâche une technologie aussi mimétique sur une espèce aussi mimétique que la nôtre ? (réponse : catastrophe). Ce sera une conférence théorique, mais avec de nombreux exemples : de l'arrière-plan de Peter Thiel et Girard à "Humanity's last exam" en passant par le narcissisme de résonance en ligne. »
Né en 1961, philosophe de formation, Sébastien Marot a été délégué général de la Société Française des Architectes de 1986 à 2002 où il a fondé et dirigé la Tribune d’histoire et d’actualité de l’architecture, puis la revue Le Visiteur. Ses recherches et ses publications ont porté sur la généalogie des théories et des pratiques contemporaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’architecture de paysage, et en particulier sur la mise en scène de l’épaisseur historique des situations construites par ces différentes disciplines.
Accueilli comme chercheur au Centre Canadien d’Architecture de Montréal en 2004-2005, Sébastien Marot a soutenu en 2008 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, une thèse d’histoire intitulée Palimpsestuous Ithaca, profilée comme un « manifeste relatif du suburbanisme ». Il travaille aujourd’hui à la publication de cette thèse. Ses essais et recherches sur l’architecture et le paysage conduiront l’Académie d’architecture à lui décerner la médaille de l’analyse architecturale en 2004 puis le prix de la recherche et de la thèse de doctorat en architecture en 2010.
En marge de ses activités éditoriales et critiques, Sébastien Marot a été invité à enseigner dans de nombreuses écoles d’architecture ou de paysage en Europe et aux États-Unis : IAUG (Genève), ENSP (Versailles), AA School (Londres), GSD Harvard (Boston), Upenn (Philadelphie), Cornell (Ithaca), Université de Montréal, ETHZ (Zürich) etc. Il est aujourd’hui maître-assitant à l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est dont il est un des membres fondateurs et où il enseigne, tout comme à Harvard et à l’EPFL, l’histoire de l’environnement et les problématiques environnementales liées à l’architecture et au paysage.
Marcel O’Gorman est titulaire d’une chaire de recherche universitaire, professeur d’anglais et directeur fondateur du Critical Media Lab (CML). O’Gorman a publié de nombreux écrits sur les impacts de la technologie sur la société, y compris son livre le plus récent Necromedia. Il est également un artiste avec un parcours international d’expositions et de performances. Cette expérience guide les méthodes de recherche et de création adoptées par le Critical Media Lab et décrites en détail dans son ouvrage Making Media Theory (Bloomsbury, 2020). Ses recherches récentes portent sur les enjeux éthiques, épistémologiques et politiques de la numérisation du monde, suivant une démarche réunissant des chercheurs en sciences sociales, et experts des technologies numériques.
Gundolf S. Freyermuth est un auteur et un éditeur qui a publié une vingtaine d'ouvrages de fiction et de non-fiction. En 2010, il a fondé (avec le professeur Björn Bartholdy) le Cologne Game Lab, qui est devenu l'une des principales institutions européennes dans le domaine de l'éducation et de la recherche en matière de jeux. Son enseignement et ses recherches en tant que professeur d'études sur les médias et les jeux se concentrent sur l'audiovisualité linéaire et non linéaire, le transmédia et la culture numérique.
Icare Bamba travaille dans le milieu du jeu vidéo. Game/ narrative designer en freelance, il intervient en 3e année de BUT MMI afin de donner des cours de narration.